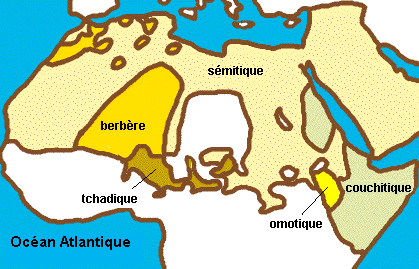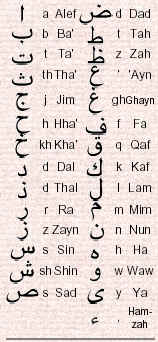Le groupe chamite ne compte qu’une seule langue, l’égyptien
(3000 ans avant
notre ère), qui a donné naissance à l'égyptien ancien, à l'égyptien
moyen, au nouvel égyptien, au démotique, puis au copte. La langue égyptienne s'étale pratiquement sur quelques milliers d'années. Son évolution commence
avec l'ancien égyptien dont la plus
ancienne forme remonterait à près de 3000 avant notre ère. C'est la langue
qu'on retrouve dans les textes des pyramides et des inscriptions de la
IIIe à la VIe dynastie de l'Ancien Empire. Les premières
attestations du moyen égyptien (ou égyptien
classique) sont apparues vers 2100 avant notre ère; cette langue, qui a
survécu durant environ 500 ans, demeure la «langue des hiéroglyphes» dans
histoire de l'Égypte antique, lors de la période du Moyen Empire. Sous la XVIIe
dynastie, le moyen égyptien a été adopté comme langue officielle (textes
littéraires, inscriptions royales, documents administratifs, etc.); on le
retrouve aujourd'hui sur les inscriptions des sarcophages. Quant au nouvel
égyptien (ou néo-égyptien), il a remplacé en Haute Égypte le
moyen égyptien dans la langue parlée (après l'an 1600 avant notre ère) et
est resté en usage jusqu'aux environs de l'an 600 (avant notre ère). Le nouvel
égyptien a été employé dans les documents officiels durant la période
s'étendant entre les XIXe et XXVe dynasties.
Lors de la Basse Époque, deux
variétés d'égyptien et deux écritures dérivées du nouvel égyptien ont
été utilisées simultanément: d'une part, le démotique
«archaïque» dans le Nord, d'autre part, le hiératique
«anormal» dans le Sud. L'unification s'est faite du Nord au Sud en faveur du démotique
sous le règne de Psammétique Ier. Cette appellation de démotique
(du grec dêmos signifiant «populaire») désigne une langue restée en
usage jusqu'au VIIe siècle de notre ère, soit jusqu'à la conquête arabe qui a
entraîné l’arabisation et l’islamisation de cet ancien empire. Dans l'écriture,
le terme de démotique fait référence à la «langue populaire» employée
dans la vie quotidienne, tandis que les inscriptions officielles en hiéroglyphes
ont tendance à désigner les styles archaïques de l'Ancien Empire et du Moyen
Empire.
Pour ce qui est du copte
(du grec Aiguptos signifiant «égyptien), c'est le dernier maillon dans
l'évolution de l'ancien égyptien. Attesté dès le IVe siècle avant
notre ère, le copte a été employé par les paysans de Haute Égypte jusqu'au
au XVIIe siècle et reste aujourd'hui la langue liturgique de l'Église
copte orthodoxe (environ 6,5 millions d'adeptes). L'écriture copte est la transcription de la langue égyptienne
en lettres grecques complétée par sept caractères démotiques pour rendre les
sons qui n'existaient pas en grec. On sait qu'en 642 l'Égypte fut conquise par
les Arabes qui arabisèrent et islamisèrent la région avant d'entreprendre la
conquête d'une partie du monde.
3
Les langues sémitiques
Certaines langues sémitiques sont attestées
depuis 2000 ans
avant notre ère (akkadien, ougaritique, éblaïte, etc.). Dans le groupe sémitique,
seuls l’arabe (200 millions de locuteurs),
l'amharique (20 millions de locuteurs
dans le monde), le tigrinia (6 millions)
et l’hébreu (4,6 millions) constituent
des langues officielles, soit dans 23
États pour l'arabe, en Éthiopie pour l'amharique, en Érythrée pour le
tigrinia et en Israël pour l'hébreu. La plupart des autres langues sémitiques
(73 au total) parlées aujourd’hui sont utilisées en Éthiopie et en Érythrée.
3.1
La langue arabe
L'arabe, pour sa part, doit sa formidable expansion à
partir du VIIe siècle grâce à la propagation de l'islam, la
diffusion du Coran et la puissance militaire des Arabes. Ces trois
facteurs sont intimement liés au point qu'on ne peut que difficilement les
dissocier. La langue arabe se présente sous deux formes principales: l'arabe
dialectal et l'arabe littéraire (ou arable classique ou arabe du
Coran). L'arabe dialectal résulte à la fois de la fragmentation de l'arabe du
VIIe siècle et de la fusion des parlers provenant des conquêtes
militaires et des brassages de population des langues sud-arabiques, berbères,
africaines, etc. Ces variétés dialectales sont, de nos jours, extrêmement
nombreuses et persistent dans tout le monde arabe. L'arabe dialectal est la
langue que chacun des 200 millions d'arabophones utilise toute sa vie et qui
véhicule toute une culture populaire, traditionnelle et contemporaine. Il est
fortement dévalorisé au plan social et est souvent perçu comme «vulgaire»
ou «abâtardi». C'est donc une langue exclusivement parlée dont les variétés
sont souvent incompréhensibles entre les arabophones. On distingue
principalement l'arabe algérien, l'arabe égyptien, l'arabe irakien, l'arabe
jordanien, l'arabe libanais, l'arabe libyen, l'arabe marocain, l'arabe
mauritanien, l'arabe omanais, l'arabe palestinien, l'arabe saoudien, l'arabe
syrien, l'arabe tchadien, l'arabe tunisien, l'arabe yéménite, etc.
Au contraire, l'arabe classique,
appelé aussi arabe éloquent ou arabe grammatical, est une langue
prestigieuse associée à la religion et à l'écrit, c'est-à-dire à la culture
littéraire, à la science, à la technologie et aux fonctions administratives.
De très forts liens historiques et idéologiques unissent ces deux formes d'arabe;
c’est pourquoi les communautés arabes ont toujours considéré qu'il n'existe
qu'une langue arabe. Sur le continent africain
ainsi qu’au Proche-Orient, l’arabe est
officiel dans 23 États,
ce qui en fait une langue de très grande diffusion.
3.2 L'écriture arabe
L'alphabet arabe moderne et l'alphabet hébreu se sont
développés à partir de la variante araméenne, laquelle a également
donné naissance à l'alphabet grec. L'araméen a été supplanté à
son tour par l'arabe. L'illustration de droite représente le mot Xavier
en arabe moderne.
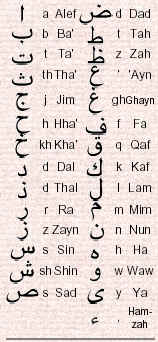 |
L'alphabet arabe est composé de 28
lettres. Il s'écrit
de droite à gauche,
contrairement à l'alphabet latin. Comme
pour le français, la position de la lettre par rapport à ligne d'écriture
est importante.
L'une des originalités de cette
écriture est qu'elle est consonantique,
c’est-à-dire
que seules les consonnes sont en général écrites ainsi que les voyelles
longues; l’arabe est une langue dans laquelle les voyelles ne servent
qu’à préciser la fonction grammaticale du mot et non son sens.
Mais chaque
lettre possède une forme différente selon sa place dans le mot.
L'écriture
arabe sert à noter de nombreuses langues non chamito-sémitiques:
des langues iraniennes
(farsi), turques
(le turc sous l'Empire ottoman jusqu'en 1928),
indiennes (ourdou),
austro-asiatiques (malais) et
africaines. Pour
noter les sons de ces langues qui n'existent pas en arabe, on utilise des
points ou des signes diacritiques conférant à la lettre arabe une
nouvelle valeur phonétique.
|
Quant aux chiffres
dits «arabes» utilisées en Occident, ils constituent la forme maghrébine des
chiffres indiens (entre le Ie et le VIIe siècle), les
Arabes ayant, au moment des croisades, servi de relais depuis l'Inde jusqu'en
Occident. On devrait plutôt parler de «chiffres indo-arabes». C'est le pape
Sylvestre II qui, vers l'an 1000, a imposé, non sans difficulté, ce système
à la chrétienté (encore restée aux chiffres romains ou grecs ). Les
premières apparitions en Europe des «chiffres arabes» se trouvent dans deux
manuscrits espagnols écrits en latin, en 976 et 992.
4
Les langues berbères
Les langues berbères sont parlées au Maroc, en Algérie
et en Libye, avec quelques îlots en Tunisie, au Niger et au Mali. Ces langues
sont fragmentées en une trentaine de variétés et elles doivent affronter la
concurrence de l'arabe. Néanmoins, elles sont parlées par plus de 20 millions
de locuteurs. Les langues les plus connues sont les suivantes: tamazight,
kabyle, tachelhit,
tamasheq, jerba,
chaouïa, judéo-berbère, etc. Le berbère
possède son système propre d'écriture, de grammaire et de syntaxe. On peut
consulter une carte linguistique des langues berbères en Afrique en cliquant
ICI.
5
Les langues tchadiques
On compte un peu moins de 200 langues tchadiques (peut-être
140), mais la
plupart sont des langues utilisées par peu de locuteurs. De plus, ce ne sont
pas des langues reconnues par les États, sauf pour ce qui est du haoussa
parlé par environ 22 millions de locuteurs dans le monde (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Ghana, Niger, Nigeria, Soudan, Togo, Tchad). Depuis les années
quatre-vingt, près d’une vingtaine d’États non souverains de la
fédération nigériane ont rendu le haoussa co-officiel avec l’anglais à
leur chambre d’Assemblée. Au Nigeria, le haoussa est parlé par plus de 18
millions de locuteurs et par au moins 50 % de la population comme langue
seconde. Au Tchad, les langues tchadiques sont parlées dans les régions du lac
Tchad, du Moyen-Chari et du Logone, une partie du Guéra et le Ouaddai
occidental.
6
Les langues couchitiques
On compte moins de 50 langues couchitiques attestées depuis
la frontière sud de l'Égypte jusqu'au nord de la Tanzanie. Elles sont
parlées en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. La
seule langue reconnue officiellement est le somali (8,3 millions de
locuteurs dans le monde) en Somalie, mais il en existe plusieurs autres comme le
sidamo, le galla, l'afar, le gédeo, le bédja, le bédawi, etc.
7
Les langues omotiques
Les 28 langues omotiques sont parlées dans la région du
bassin du fleuve Omo en Éthiopie. Ce sont généralement de petites langues
parlées par un nombre restreint de locuteurs, mais certaines de ces langues
comptent néanmoins beaucoup de locuteurs: il s'agit d'abord du wolaytta (2
millions), puis du gamo (780 000), du yemsa (500 000), du
seze (109 000), du
basketto (82 000) et du melo (80 000).
L'appartenance du groupe des langues omotiques à la famille chamito-sémitique
fait présentement l'objet de controverses.
En somme, les langues dites «chamito-sémitiques», en tant
que famille linguistique, ne sont pas scientifiquement fondées, car
cette «famille» n'a jamais été reconstruite par la méthode de la linguistique historique,
laquelle est comparative et inductive; on sait que cette méthode, appliquée
depuis longtemps à l'indo-européen, a fait les preuves de sa pertinence et de
sa validité, mais elle n'a jamais été appliquée aux langues chamito-sémitiques. Donc,
c'est par tradition ou par habitude qu'on parle encore de langues
chamito-sémitiques ou afro-asiatiques.
Willkommen auf meiner Seite